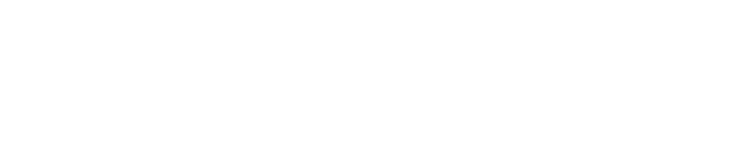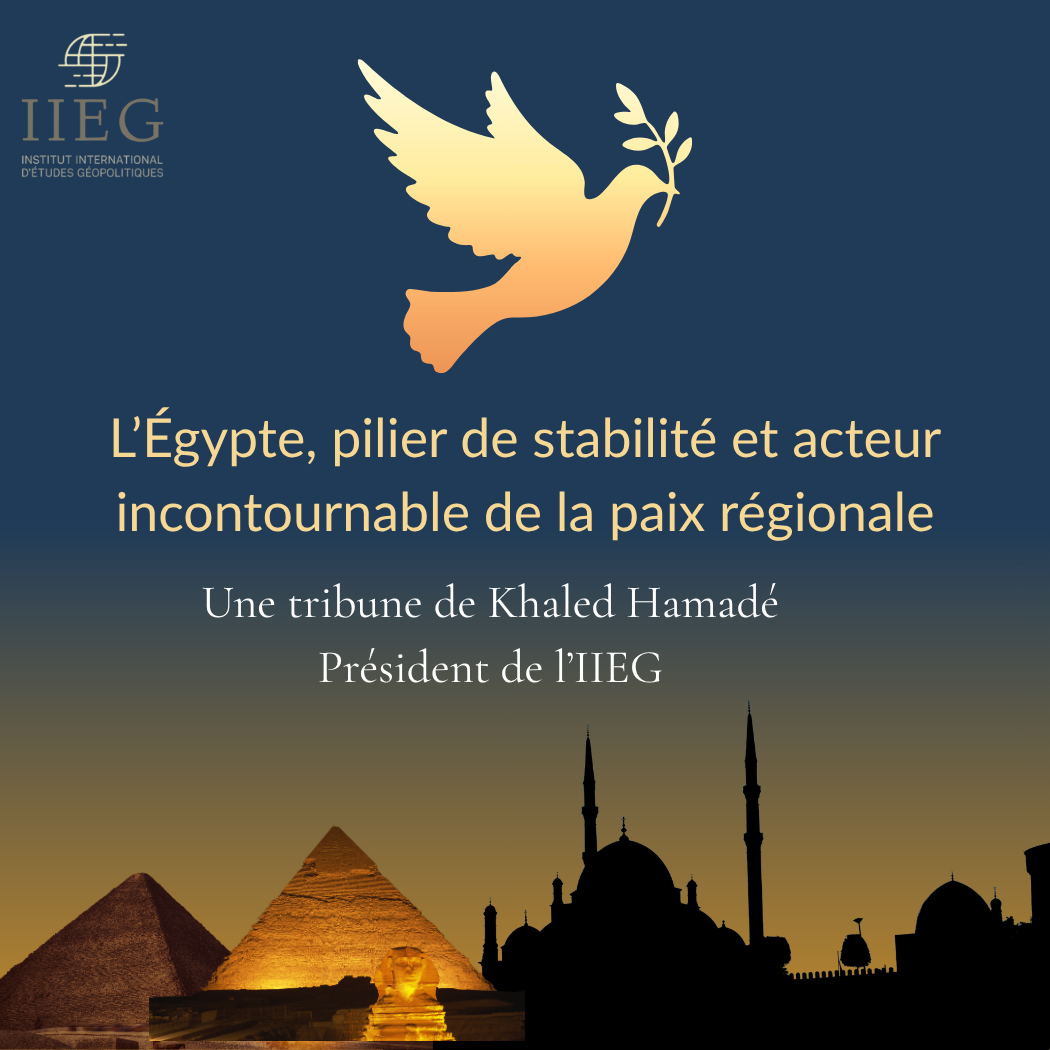Les ressources font et défont les puissances…
Dans l’histoire contemporaine, chaque époque a vu une ressource être érigée en pilier de puissance. Le charbon et l’acier au XIXe siècle, le pétrole et le gaz au XXe, les données numériques au XXIe. Ces ressources stratégiques conditionnent l’indépendance des nations, structurent les alliances et ont même le pouvoir de déclencher des conflits.
Aujourd’hui, une ressource ancestrale, que l’on prenait pour acquise, retrouve une centralité inattendue. C’est l’eau. Qualifiée d’or bleu par certains, elle est un facteur de santé et de bien-être autant qu’une variable de sécurité, de stabilité sociale et de puissance. La planète n’en manque pas en volume, mais c’est l’eau douce de bonne qualité facilement accessible aux populations qui fait défaut. Déjà, un cinquième de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable, alors que partout la demande explose avec la croissance urbaine et agricole. Les sécheresses s’intensifient, la pollution s’aggrave, et les projections démographiques annoncent une explosion du nombre de citadins avant que la population mondiale n’entame un déclin.
Tous les pays ne font pas face au même défi. Certains, comme le Brésil, héritent d’une abondance trompeuse. D’autres, comme le Maroc, sont confrontés à une rareté structurelle qui l’oblige à considérer l’eau comme un enjeu de survie et de souveraineté. Dans le nouveau hit parade des ressources stratégiques, le Royaume se trouve à la croisée des chemins. Il doit gérer la rareté de l’eau et en faire un levier de stabilité et d’influence, ou être condamné à la subir comme une vulnérabilité systémique.
Un capital hydrique en déclin.
En moins d’un siècle, le Maroc est passé d’une situation d’aisance hydrique à une inquiétante rareté. Dans les années 1960, chaque Marocain pouvait disposer en moyenne de 2500 m³ d’eau douce par an. Aujourd’hui, ce chiffre s’est effondré à environ 650 m³/habitant/an — c’est bien en dessous du seuil international de rareté fixé à 1000 m³. Cette tendance est structurelle et elle est aggravée par un climat devenu imprévisible — sécheresses fréquentes, pluies irrégulières et décalage des saisons.
Les ressources en eau du Maroc sont limitées et très inégalement réparties. Le potentiel annuel moyen du pays est estimé à 22 milliards de m³, dont 18 milliards d’eaux de surface et 4 milliards d’eaux souterraines. Mais ces chiffres masquent une forte disparité territoriale. Plus de 50% des ressources sont concentrées au Nord et au Centre, laissant le Sud et l’Est dans une vulnérabilité permanente.
L’agriculture domine largement la consommation nationale. La consommation annuelle totale atteint environ 16,3 milliards de m³, dont plus de 80 % sont en effet destinés à l’irrigation agricole. Ce modèle repose sur plus de 2 millions d’hectares irrigués, dont une part croissante est orientée vers l’exportation. Autrement dit, le Maroc exporte son eau à travers ses produits agricoles.
Le pays compte 130 nappes phréatiques (32 profondes et 98 superficielles) couvrant près de 80000 km². Mais ce patrimoine souterrain est largement surexploité. Les nappes assurent plus de 90 % de l’approvisionnement en eau potable rural et irriguent près de 40 % des surfaces agricoles. Or, leur niveau piézométrique baisse continuellement depuis plusieurs années et certaines n’arrivent plus à se reconstituer, même en années de fortes pluies.
Pressions, menaces et paradoxes.
Au Maroc, l’eau est une ressource à la fois rare et fragile. Elle irrigue les terres, alimente les villes et les industries. Mais son mode de gestion actuel révèle de profondes contradictions qui, loin de rapprocher le pays de la sécurité hydrique, aggravent au contraire sa vulnérabilité systémique.
Face à la raréfaction des eaux de surface, les prélèvements dans les nappes phréatiques se multiplient. Cette solution d’urgence épuise un capital qui s’est constitué sur des siècles. Plusieurs bassins (Tensift, Souss-Massa, Oum Er-Rbia) connaissent un déclin piézométrique alarmant. Dans certains cas, même une succession d’années particulièrement pluvieuses ne suffirait plus à reconstituer les réserves. L’épuisement devient irréversible.
À cette rareté quantitative s’ajoute une rareté qualitative. Les nappes et rivières sont contaminées par des nitrates issus des engrais et des rejets d’élevage. Dans certaines régions agricoles — Chaouia, Doukkala, Massa, Bou Areg —, les concentrations dépassent 100 mg/l, ce qui est bien au-delà de la norme sanitaire de 50 mg/l. À ces pollutions agricoles s’ajoutent les rejets domestiques et industriels, insuffisamment traités. La ressource en eau devient impropre à la consommation et coûteuse à dépolluer.
Le climat actuel du Maroc accentue d’avantage la pression. Les épisodes de sécheresse sont plus fréquents et plus longs, les pluies de plus en plus rares et irrégulières. Les prévisions annoncent une réduction de 10 à 20 % des ressources renouvelables d’ici 2050, alors même que la demande continue de croître sous l’effet de l’urbanisation.
Pour terminer, le paradoxe est institutionnel. Le Maroc dispose de lois avancées (10-95, 36-15), d’agences de bassin et de conseils spécialisés. Mais ces dispositifs souffrent de sous-financement chronique, de manque de coordination et d’un déficit de données fiables. En conséquence, la stratégie hydrique reste atomisée, réactive et davantage centrée sur l’offre que sur la demande.
Bâtir une souveraineté hydrique.
Face à l’ampleur du problème, le Maroc n’est pas inactif. De grands chantiers sont lancés, mais leur efficacité dépendra de la capacité à rapidement changer de paradigme. Il lui faut passer d’une logique de captation à une logique de gestion intégrée et durable.
Pour cela, le Royaume mise beaucoup sur la technologie. Il a engagé un programme ambitieux de dessalement de l’eau de mer, avec des stations déjà opérationnelles à Agadir ou Laâyoune et un mégaprojet prévu à Casablanca. Parallèlement, la réutilisation des eaux usées (ReUt / ReUse) pour l’irrigation et les espaces verts se développe, tout comme la modernisation des systèmes d’irrigation — grâce au goutte-à-goutte notamment. Ces innovations réduisent la dépendance aux pluies mais restent coûteuses et énergivores ce qui pose la question de leur soutenabilité à long terme.
Il faut maintenant réformer les usages agricoles du pays. Avec plus de 80% de l’eau consommée chaque année, l’agriculture est le cœur du problème… et aussi celui de la solution. Les experts recommandent de plafonner les prélèvements, de limiter les cultures trop gourmandes — agrumes, pastèques, avocats — et de promouvoir des filières sobres en eau et mieux adaptées au climat semi-aride. Il faut également revoir les logiques d’exportation de produits agricoles — qui équivalent à exporter une ressource rare.
Mais la sécurité hydrique est avant tout une question de gouvernance. Les récents rapports de l’IRES et de l’IMIS convergent, il faut mettre en place un système national unifié de données sur l’eau, faire appliquer les lois existantes, renforcer les agences de bassin, et instaurer une tarification progressive qui incitera à la sobriété. Autrement dit, il faut passer d’un modèle centré sur l’offre — barrages, forages — à une gestion intégrée de la demande.
Enfin, le Maroc doit adopter l’approche Nexus. La raréfaction de l’eau ne peut être traitée isolément. Elle est indissociable de l’énergie — besoin d’électricité pour le dessalement —, de l’agriculture — irrigation et sécurité alimentaire —, et des écosystèmes — zones humides, forêts, littoraux. L’approche Nexus c’est penser l’eau dans ses interactions systémiques. Pour le Maroc, cette approche est la seule voie vers une véritable souveraineté hydrique, qui conditionnera sa stabilité sociale et son rayonnement géopolitique.
De la pénurie à l’influence géo hydrique.
Face à une sécheresse structurelle, accentuée par la variabilité climatique, les prélèvements agricoles et une urbanisation rapide, le Royaume est à un tournant décisif. Tous les récents rapports le confirment, il faut reconfigurer le modèle, non plus autour de l’offre mais autour de la gestion durable de la demande.
Mais ce scénario peut — et doit — également devenir une opportunité de soft power hydrique. Le Maroc, à l’instar de ce qu’il a réussi dans le domaine des énergies renouvelables, pourrait à terme faire de son expérience un vecteur d’influence régionale — un modèle exportable et un hub de solutions et d’expertise. Pas en exportant de l’eau, mais en proposant des normes, des technologies et une ingénierie de la résilience. Il s’agira de construire un narratif géo hydrique fort, basé sur l’innovation et la coopération.
Dans un monde en stress hydrique permanent, les nations les plus influentes seront non seulement les plus résilientes, mais aussi celles qui auront réussi à convertir la menace en atout stratégique.