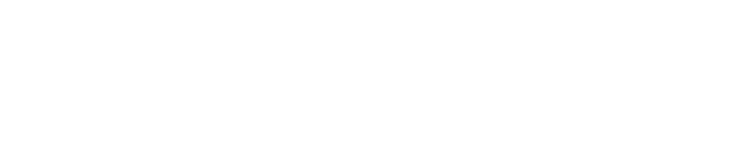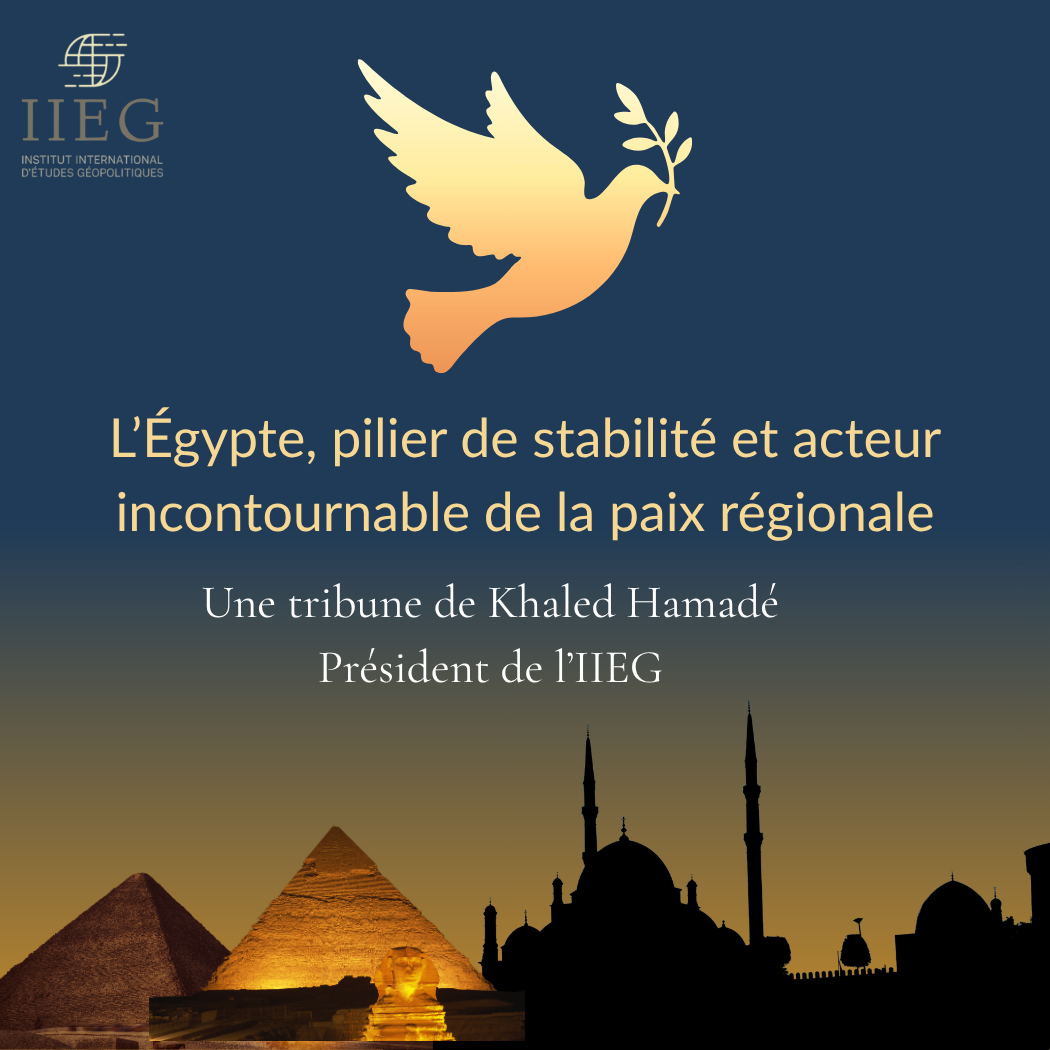Un théâtre singulier dans le monde arabe moderne
Dans l’histoire du théâtre arabe moderne, l’œuvre dramatique de Naguib Mahfouz occupe une place singulière. Si ses romans lui ont assuré une reconnaissance mondiale, son théâtre, plus discret, se présente comme un véritable laboratoire esthétique où il explore, à travers le symbolisme, les grandes crises spirituelles, politiques et sociales du monde arabe. Ses pièces Il fait mourir et fait vivre (1974) et Le Diable prêche (1981) constituent deux jalons essentiels : elles traduisent, par des figures, des espaces et des temporalités hautement symboliques, le désenchantement né de la défaite arabe de 1967 ainsi qu’une critique d’un sacré confisqué par l’idéologie.
Les titres comme clés du symbolisme
Le symbolisme s’impose d’abord dès les titres, qui condensent une stratégie d’inversion. Il fait mourir et fait vivre détourne un verset coranique pour renverser l’ordre sacré de la vie et de la mort, révélant une société où la mort est glorifiée au détriment de la vie. Le titre devient alors un symbole de l’idéologie du martyre que Mahfouz dénonce. De même, Le Diable prêche repose sur un oxymore : attribuer au Diable la fonction de prédicateur. Ce paradoxe symbolise le déplacement de la vérité, qui ne réside plus dans le discours officiel mais dans la voix marginale et interdite. L’inversion, en tant que procédé symbolique, traduit la volonté de Mahfouz de faire vaciller les évidences religieuses et d’interroger l’usage politique du sacré.
Temps et espaces scéniques symboliques
Ce recours au symbolisme structure également le temps et l’espace scéniques. Dans ces deux pièces, le temps n’est jamais daté : il est suspendu, cyclique, répétitif, figure dramatique de l’impasse spirituelle. Le décor devient lui-même un langage symbolique. Dans Il fait mourir et fait vivre, la roue à eau représente le cycle de la vie, tandis que le mastaba incarne la mémoire figée et la glorification morbide du passé. Le Jeune Homme, oscillant entre ces deux pôles, apparaît comme la figure symbolique de la conscience en quête de vérité. Dans Le Diable prêche, la Cité d’airain matérialise un univers clos, autoritaire, figé dans ses lois, où seules les marges – prison, exil, rue – laissent filtrer une vérité possible. Le symbolisme spatial traduit ainsi le conflit entre vie et mort, lumière et obscurité, liberté et oppression.
Personnages, parole et didascalies : une allégorie du monde arabe
Les personnages relèvent d’une typologie symbolique plus que d’une psychologie réaliste. Le Géant incarne la religion de la terreur, caricature d’un pouvoir qui parle au nom d’Allah pour imposer la mort. La Jeune Fille, lumineuse et silencieuse, symbolise au contraire une foi poétique et soufie, enracinée dans l’amour et la compassion. Le Diable, paradoxalement, devient l’emblème d’une vérité déplacée : il incarne la lucidité marginale qui ose dire ce que nul ne veut entendre. Même le silence et les gestes – se boucher les oreilles, rire ironiquement, avancer doucement – acquièrent une valeur symbolique, codifiant les rapports de force et les choix spirituels. Le théâtre de Mahfouz devient ainsi une fresque allégorique où chaque personnage, chaque objet, chaque posture traduit un état de la conscience arabe contemporaine.
La parole dramatique comme instrument critique
La parole dramatique, elle aussi, ne se réduit pas à un dialogue réaliste mais fonctionne comme un signe symbolique. Le discours du pouvoir, qu’il soit porté par le Géant ou les Juges, est une parole figée, stéréotypée, symbole de l’enfermement idéologique. À l’inverse, la parole rare de la Jeune Fille, le silence du Cheikh ou l’ironie du Diable symbolisent une vérité qui échappe au contrôle. Le théâtre devient alors le lieu où la vérité se déplace vers les marges, où le symbolisme de la voix faible ou du silence déconstruit le verbe tonitruant de l’autorité.
Didascalies et contrastes scéniques
Les didascalies participent également à cette architecture symbolique. Les contrastes entre lumière et obscurité, les silences pesants, les gestes codifiés, tout cela compose une chorégraphie où la scène devient métaphore du monde arabe post-1967 : un espace clos, conflictuel, où la vérité cherche à se dire par des signes détournés. La lumière entourant la Jeune Fille symbolise la transparence de la foi vécue ; l’obscurité enveloppant le Géant traduit le dogme mortifère. Les pauses silencieuses du Diable deviennent des symboles d’une vérité suspendue, que le spectateur est invité à compléter par sa propre conscience.
Portée critique et spirituelle du symbolisme chez Mahfouz
En définitive, le symbolisme dans le théâtre de Mahfouz dépasse le simple registre esthétique pour constituer une stratégie critique. C’est par le symbole qu’il dénonce l’instrumentalisation du religieux, qu’il révèle la crise de la conscience arabe et qu’il esquisse une issue spirituelle. Le théâtre n’y reproduit pas le réel, il le métaphorise : il invite le spectateur à décrypter les signes et à reconstruire du sens. La foi qui en émerge n’est pas institutionnelle mais poétique et intérieure : elle se loge dans la lumière, le silence, l’amour et même dans la provocation paradoxale du Diable. Le symbolisme devient ainsi vecteur de résistance spirituelle, une manière de redonner souffle au sacré face à son détournement idéologique.
À travers Il fait mourir et fait vivre et Le Diable prêche, Mahfouz élabore un théâtre où tout est symbole : le titre, le décor, les personnages, la parole, le silence, la lumière. Ce théâtre symbolique, loin d’être une simple expérimentation formelle, se révèle une arme de dévoilement et de résilience. Il ouvre un espace où le sacré se régénère en se libérant du pouvoir, et où l’art dramatique retrouve sa fonction de miroir spirituel et critique, appelant à une réconciliation de l’humain avec sa vérité intérieure.