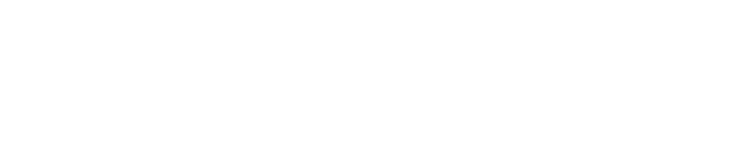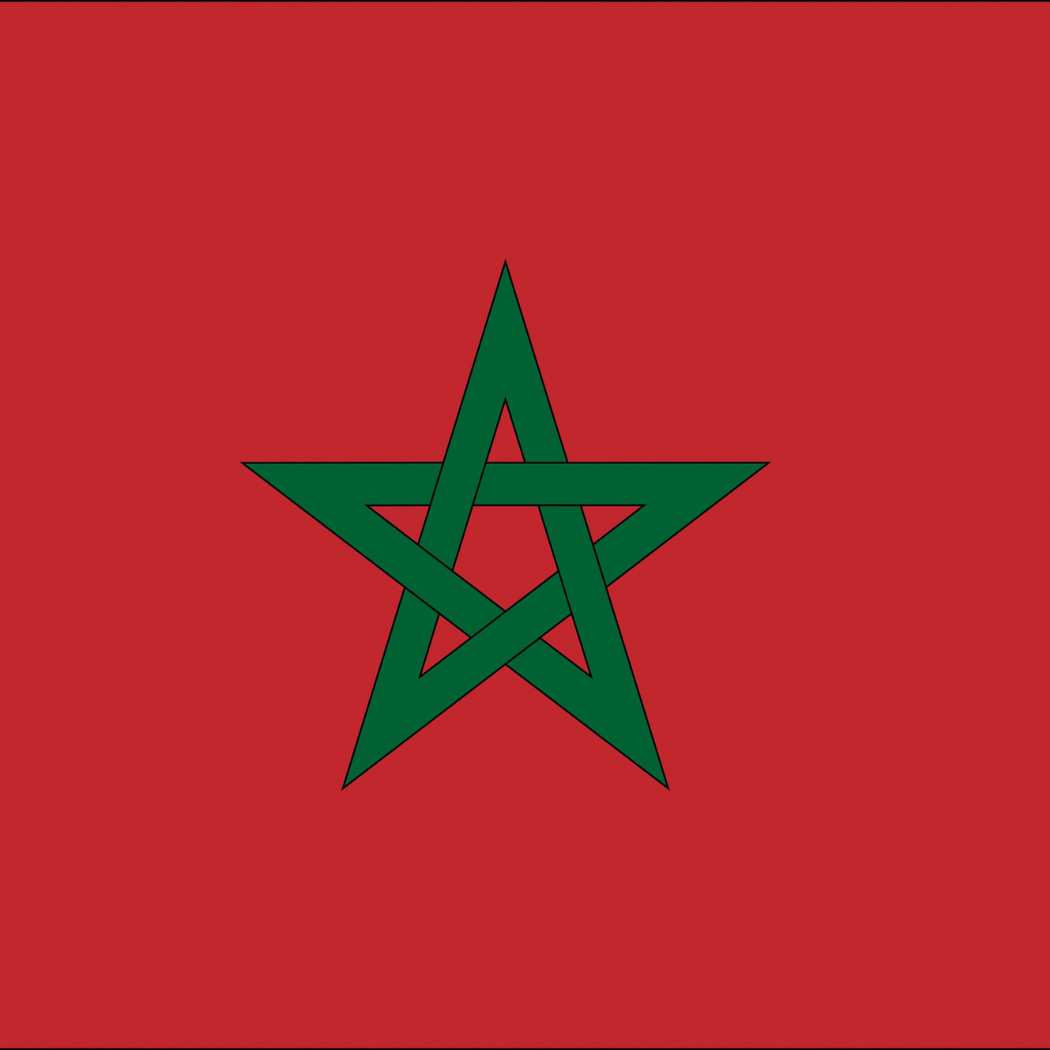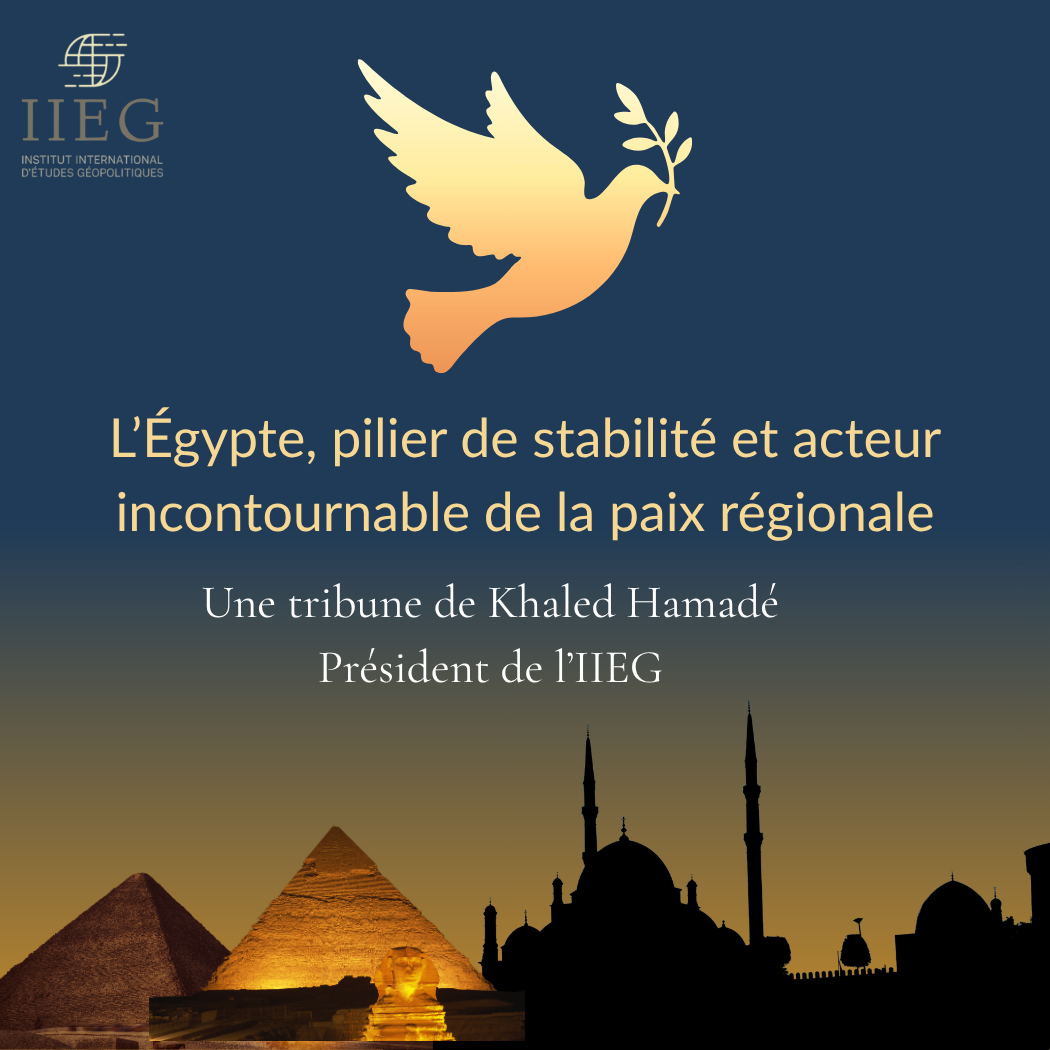La Chine impose sa norme sur la transformation des métaux stratégiques
Pékin contrôlait la ressource, il réglemente désormais les procédés qui la convertissent en puissance industrielle
Début octobre, le ministère chinois du Commerce (Mofcom) a étendu son régime de licences d’exportation aux terres rares, aimants permanents, matériaux “superdurs” et technologies associées. Nouveauté décisive : l’obligation de licence peut s’appliquer même à des biens fabriqués hors de Chine s’ils contiennent des matériaux d’origine chinoise ou des composants produits avec une technologie chinoise, un pas assumé vers l’extraterritorialité des contrôles, jusqu’ici marque de fabrique américaine. Des cabinets spécialisés détaillent une “règle des 50 %” : au-delà d’un certain seuil de contenu rare-terre chinois ou de dépendance à des procédés chinois, une autorisation de Pékin devient nécessaire, y compris pour des exportations réalisées par des acteurs non chinois.
Instrument de politique d’État
Cette bascule intervient alors que la Chine domine déjà l’aval de la filière : environ 70 % de la production minière mondiale de terres rares et 90 % des capacités de séparation/raffinage. Autrement dit, Pékin ne contrôle plus seulement la matière ; il réglemente l’accès au procédé qui transforme la ressource en puissance industrielle (aimants NdFeB, cibles de pulvérisation, alliages stratégiques). Les marchés l’ont
compris : ces contrôles sont pensés comme des instruments de politique d’État, pas de simples mesures commerciales.
La décision de licences d’exportation conditionne l’accès à la transformation, y compris lorsque la matière ou l’usine ne sont pas en Chine.
La communication chinoise assume par ailleurs une logique d’escalier : après le gallium, le germanium et le graphite en 2023, voici les aimants, les poudres et des briques technologiques du dur industriel (batteries, aimantation, abrasifs, semi- conducteurs). Des industriels occidentaux, d’ASML aux grands équipementiers, disent avoir des stocks et des sources alternatives à court terme, mais reconnaissent un risque structurel si le durcissement se prolonge.
De l’or noir aux terres rares
Au tournant des années 2000-2010, les États-Unis et la Chine étaient à parité stratégique sur un point clé : tous deux dépendaient des importations d’hydrocarbures. La révolution du schiste a rompu cette symétrie. À partir de 2015 et surtout depuis 2019, l’équation énergétique américaine s’inverse : Washington devient exportateur net sur l’année, gagne un avantage-coût et une autonomie logistique (moindre dépendance aux routes maritimes). Pékin, lui, reste durablement importateur net de pétrole et de gaz. Sur l’énergie, l’avantage est donc aux Américains.
Mais la bifurcation technologique déplace le centre de gravité. Dans l’économie des aimants haute performance, des moteurs électriques, des éoliennes, des capteurs de précision et des chaînes défense/optique/puissance, les terres rares deviennent la ressource pivot. Et sur ce terrain, l’avantage structurel est chinois. L’asymétrie ne tient pas tant au minerai qu’à l’aval : chimie, métallurgie, procédés et savoir-faire. La décision de licences d’exportation d’octobre verrouille précisément cet aval par le droit: elle conditionne l’accès à la transformation, y compris lorsque la matière ou l’usine ne sont pas en Chine.
L’extraterritorialité chinoise : un palier de puissance
L’extension “extraterritoriale” du contrôle chinois marque un palier de puissance car elle déplace la norme là où se joue désormais l’avantage : l’aval des matériaux critiques. Jusqu’ici apanage de Washington, l’extraterritorialité s’applique désormais aux biens fabriqués hors de Chine dès lors qu’ils incorporent matière, procédé ou propriété intellectuelle chinois. La conformité ne dépend plus seulement du pays exportateur, mais aussi de la puissance-pivot du procédé. Or cet aval alimente précisément les chaînes qui feront l’économie de la décennie : semi-conducteurs, IA, électrification, défense de haute intensité, toutes matériaux-intensives. En plaçant sous licence l’accès à ses chimies, séparations et alliages, Pékin ne décrète pas un embargo : il contrôle le tempo, peut différer ou autoriser selon ses priorités, et oblige entreprises et États à vivre à l’ère de l’extraterritorialité du droit chinois.
Concrètement, c’est un levier sur la vitesse d’équipement des usines occidentales, donc sur la cadence d’adoption des technologies qui dessineront l’avantage compétitif à venir.
La Maison-Blanche a vite réouvert le canal politique en maintenant une rencontre au sommet avec Xi Jinping, signe que la coercition pure ne suffit pas.
Gestion des interdépendances sino-américaines
En toile de fond, la surenchère tarifaire annoncée par Donald Trump – jusqu’à 100 % sur certains flux chinois – rappelle que Washington dispose d’un levier redoutable : la profondeur de son marché intérieur. Mais face à une Chine dont la puissance exportatrice irrigue des pans entiers de l’offre mondiale, l’arme douanière a un coût politique immédiat : la pression inflationniste aux États-Unis et le renchérissement des chaînes d’approvisionnement. D’ailleurs, après avoir brandi la menace, la Maison- Blanche a vite réouvert le canal politique en maintenant une rencontre au sommet avec Xi Jinping, signe que la coercition pure ne suffit pas, et que l’équation passe aussi par la gestion des interdépendances.
Au fond, tout ramène à la même réalité : nous ne sommes pas dans un épisode commercial de plus, mais dans une compétition d’hégémonie. L’Amérique ancre son avantage par l’énergie, le marché et la norme ; la Chine installe le sien par les matériaux, l’aval industriel et, désormais, l’exportation de son droit. La décennie qui s’ouvre arbitrera moins une rupture qu’un duel de tempos — qui, de Washington ou de Pékin, imposera sa cadence au cœur des technologies qui feront la croissance de demain.