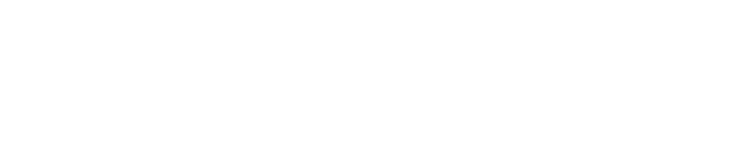Un pays au bord de la soif
Le Maroc traverse aujourd’hui une pénurie hydrique sans précédent. Longtemps considéré comme un modèle en matière de politique hydraulique, le Royaume se retrouve confronté à une sécheresse prolongée, qui fragilise à la fois son économie, sa société et sa stabilité environnementale. De Casablanca aux campagnes du Tadla, la population vit au rythme des coupures, des puits asséchés et des récoltes compromises.
Depuis 2018, les années de stress hydrique se succèdent, culminant en 2024 avec une disponibilité d’eau tombée à moins de 500 m³ par habitant et par an, soit le seuil international de pauvreté hydrique. À cela s’ajoute une baisse du PIB à 3,2 %, une chute de 38 % du cheptel national, et des barrages à moins de 40 % de leur capacité.
La réponse royale : une stratégie nationale pour la souveraineté hydrique
Face à cette urgence, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été décisif. Dans son discours du 29 juillet 2024, le Souverain a fixé un cap clair : faire de la question de l’eau une priorité nationale absolue.
Parmi les mesures phares :
- Dessalement : produire 1,7 milliard de m³ d’eau par an d’ici 2030, avec plus de 17 stations, dont la plus grande d’Afrique à Casablanca.
- Barrages : 16 nouveaux grands barrages en construction, pour une capacité additionnelle de 4,4 milliards de m³.
- Transferts interbassins : lancement des premières autoroutes de l’eau.
- Irrigation localisée : équiper 1 million d’hectares en goutte-à-goutte d’ici 2030.
Le Maroc transforme ainsi ses contraintes naturelles en catalyseurs de modernisation.
L’innovation au cœur de la réponse
Le recours massif aux technologies de pointe marque une rupture stratégique. Le dessalement, longtemps marginal, devient central. La station de Casablanca, portée par Veolia, alimentera plus de 7 millions de personnes. D’autres projets impliquent la Chine ou les Émirats Arabes Unis, avec des stations fonctionnant à l’énergie solaire pour réduire leur empreinte carbone.
Dans les zones rurales, l’irrigation de précision se généralise. À Tadla, plus de 67 000 hectares ont déjà été convertis, avec à la clé des économies d’eau de 60 % et des rendements accrus. L’usage de capteurs, de logiciels d’analyse et de pompes solaires ouvre la voie à une agriculture climato-intelligente.
Même l’industrie s’adapte : le groupe OCP construit une station de dessalement à Jorf Lasfar, reliée à un pipeline de 219 km, pour sécuriser ses opérations tout en soulageant les ressources publiques.
Une diplomatie de l’eau tournée vers l’Afrique
Conscient que la crise de l’eau ne s’arrête pas aux frontières, le Maroc déploie une véritable diplomatie hydrique. Il partage son savoir-faire avec plusieurs pays africains, conclut des partenariats technologiques (Hongrie, Émirats), et positionne ses entreprises comme des acteurs clés à l’export.
Cette approche solidaire fait du Maroc un hub continental de la gestion de l’eau, capable d’inspirer des modèles reproductibles dans des environnements similaires.
Des signes d’espoir… et un avertissement
Après six années critiques, 2025 marque une amélioration des précipitations. Les barrages reprennent du volume (+45 % sur un an), les cultures redémarrent, et les nappes commencent à se stabiliser. Mais comme le rappelle le ministre de l’Équipement et de l’Eau, ces pluies ne doivent pas conduire au relâchement.
Le dérèglement climatique impose une adaptation structurelle : alternance de sécheresses longues et d’épisodes pluvieux intenses, baisse de la fiabilité des saisons, risques accrus de conflits d’usage.
Le Maroc, modèle d’adaptation en Afrique
L’eau est devenue le miroir de la souveraineté nationale. En construisant ses capacités de production (dessalement), de stockage (barrages) et de distribution (transferts), le Maroc affirme sa résilience face au climat.
Mais cette réussite n’est possible qu’avec l’implication de tous :
- l’État qui investit,
- les agriculteurs qui modernisent,
- les industriels qui optimisent,
- et les citoyens qui économisent.
Le Maroc de 2030 se dessine aujourd’hui : plus indépendant, plus innovant, plus solidaire. Dans chaque station, chaque goutte, chaque champ irrigué, s’écrit une nouvelle page de la transition hydrique du Royaume.