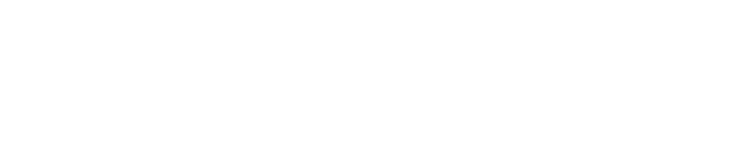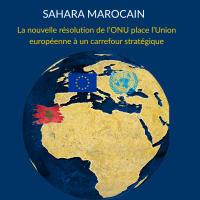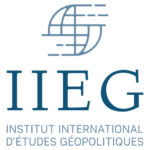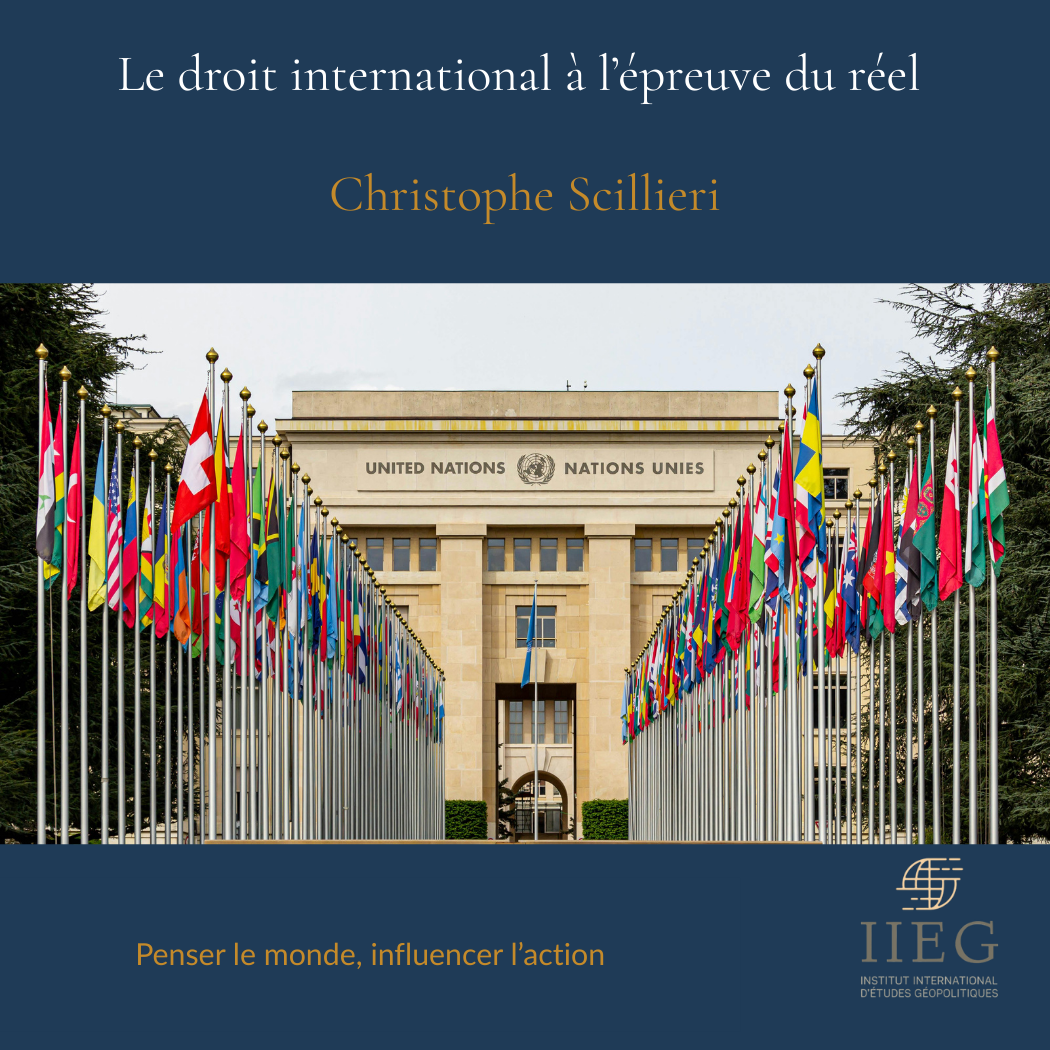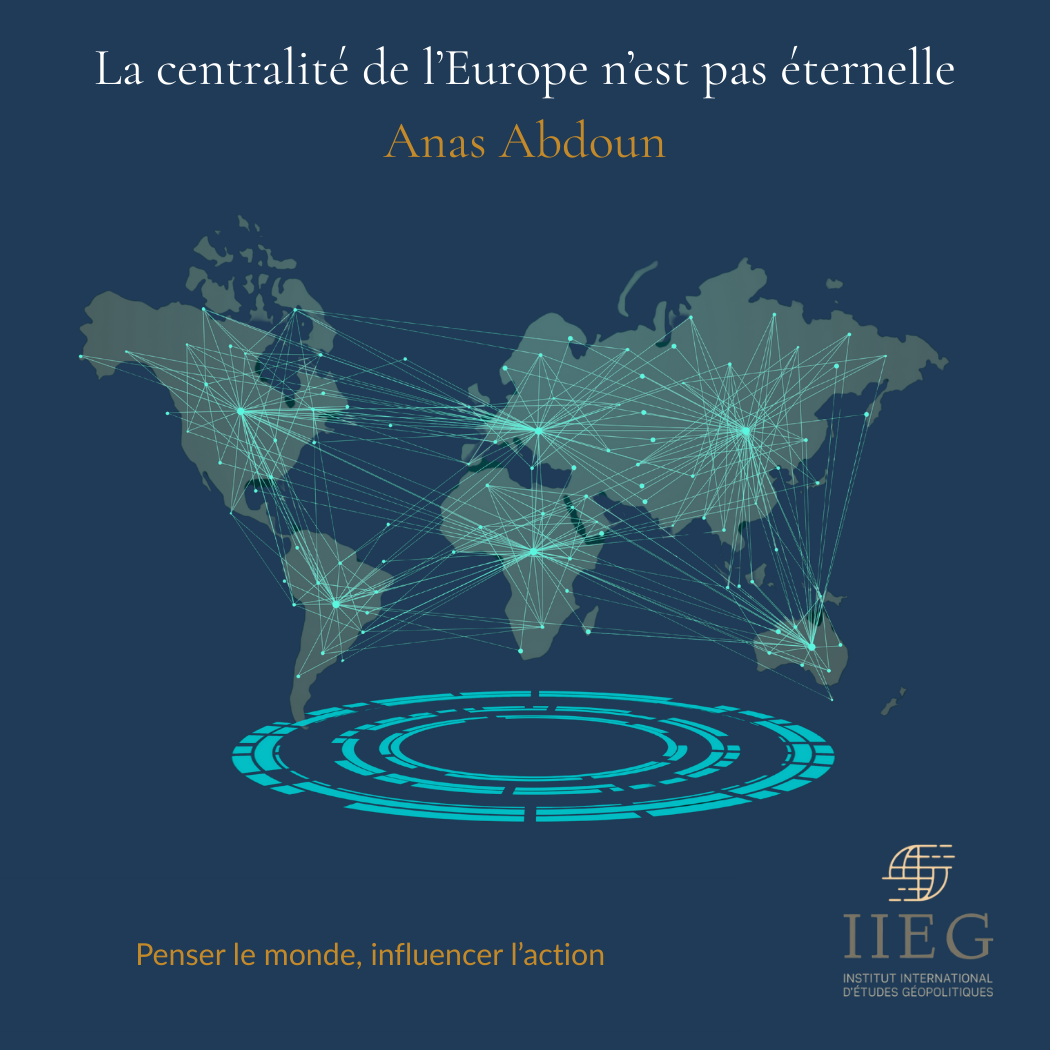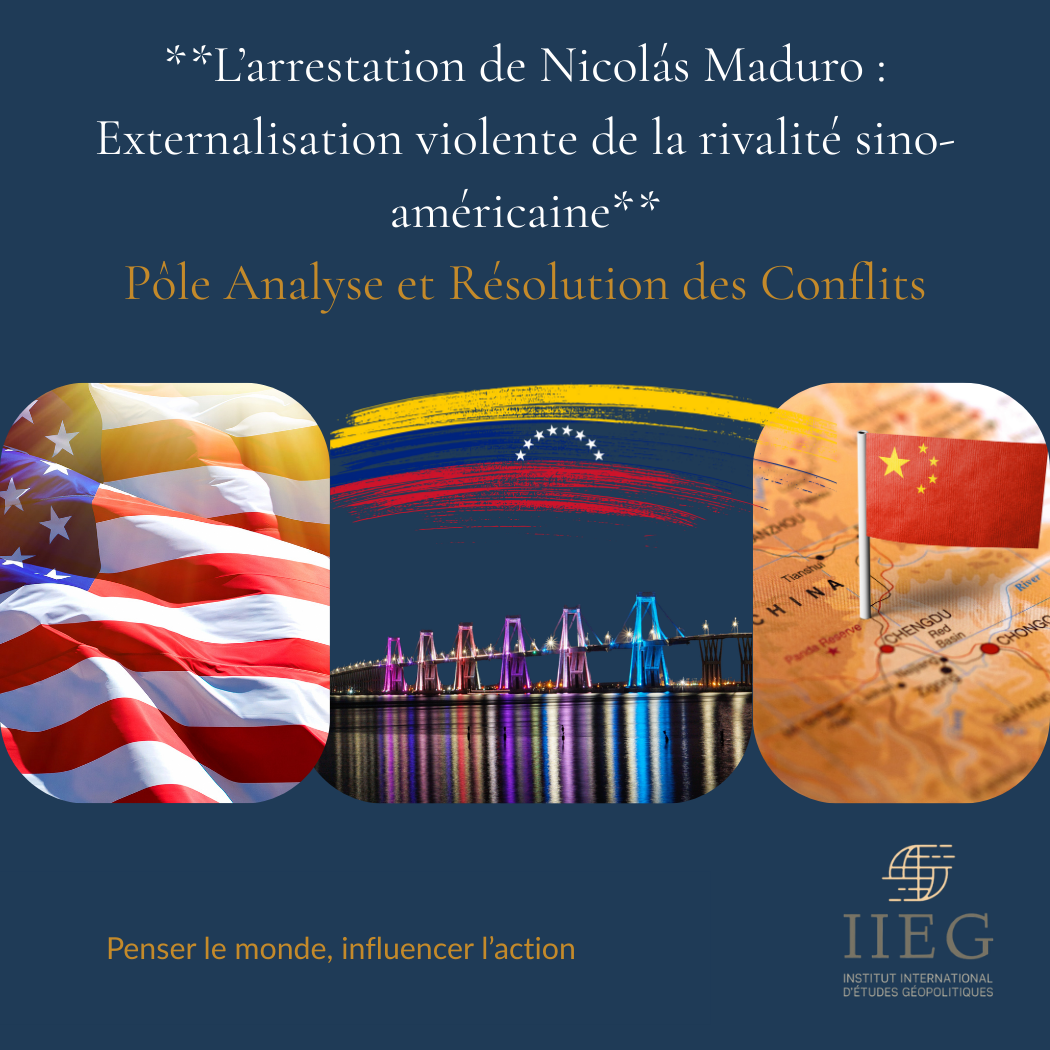Résumé analytique
L’adoption, le 30 octobre 2025, de la résolution S/2025/692 par le Conseil de sécurité des Nations Unies marque une inflexion historique dans la gouvernance du dossier du Sahara marocain.
En consacrant explicitement l’Initiative marocaine d’autonomie (présentée en 2007) comme la seule base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique négociée, la communauté internationale a fait le choix du réalisme politique et de la paix durable.
Cette évolution place l’Union européenne (UE) devant une responsabilité stratégique majeure : s’aligner sur la légitimité onusienne et sur la dynamique internationale portée par les États-Unis, les pays du Golfe, et la majorité du continent africain.
Refuser cet alignement reviendrait à entretenir une ambiguïté incompatible avec les principes de cohérence et de partenariat global que l’UE revendique dans son action extérieure.
Un tournant historique et juridique dans le traitement du dossier
La résolution S/2025/692 ne se limite pas à proroger le mandat de la MINURSO. Elle introduit une véritable relecture du processus politique, dans un triple mouvement de clarification, de recentrage et de responsabilisation.
La consécration juridique de l’Initiative marocaine d’autonomie
Depuis sa présentation en avril 2007, le plan marocain d’autonomie a progressivement gagné en reconnaissance internationale.
Décrit à maintes reprises par le Conseil de sécurité comme “sérieux et crédible” (Rés. 1754, 1783, 1813, 1979, 2099, 2468, 2602, 2654), il est désormais érigé en référence exclusive dans la résolution S/2025/692.
Cette évolution marque la marginalisation définitive de l’option référendaire, jugée irréaliste par l’ONU depuis le rapport de James Baker II (2004)[1].
“Le référendum d’autodétermination, dans les conditions actuelles, est devenu une fiction diplomatique. L’autonomie sous souveraineté marocaine est le seul cadre viable de stabilité.”
— Extrait du rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité, 2025[2].
Le texte de la résolution s’inscrit donc dans une continuité rationnelle : il consolide l’approche de “solution politique réaliste, pragmatique et durable” telle qu’exprimée dans les résolutions postérieures à 2018, mais franchit un seuil en élevant l’autonomie au rang de solution exclusive.
La reconnaissance explicite du rôle de l’Algérie
Autre innovation majeure : le Conseil de sécurité désigne désormais l’Algérie comme partie prenante au processus.
Cette reconnaissance rompt avec la rhétorique diplomatique qui la présentait comme un simple “État voisin”.
Elle entérine une lecture géopolitique du conflit fondée sur la responsabilité régionale directe et non sur une abstraction coloniale.
Cette évolution met fin à une asymétrie diplomatique longtemps exploitée pour retarder le processus politique.
La doctrine du réalisme politique
La résolution S/2025/692 réaffirme que la solution doit être “mutuellement acceptable”, mais précise que l’autonomie “constitue la voie la plus réaliste et la plus réalisable”.
Cette formulation, soutenue par les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis, traduit la consolidation d’un consensus international autour du réalisme, à rebours des postures idéologiques du XXe siècle.
Le Sahara marocain : de la diplomatie à la gouvernance territoriale
Au-delà du cadre onusien, la crédibilité de la position marocaine repose sur une réalité de terrain irréfutable : celle d’un territoire en paix, structuré, et pleinement intégré au modèle de développement national.
Les provinces du Sud : un modèle de stabilité et de développement
Le Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, a mobilisé plus de 80 milliards de dirhams autour d’axes structurants :
- Port atlantique de Dakhla, futur hub entre l’Afrique et l’Europe ;
- Parcs éoliens et solaires de Laâyoune, Boujdour et Aftissat ;
- Usines de dessalement de l’eau de mer et projets d’irrigation durable ;
- Routes et liaisons aériennes intégrant la région au réseau logistique national.
Ces investissements témoignent d’une vision stratégique : faire du Sahara un pôle de croissance et un trait d’union afro-atlantique.
L’ONU, la Banque mondiale et la BAD reconnaissent désormais cette trajectoire comme une réussite de développement territorial intégré[3].
Une dynamique sociale et institutionnelle
L’autonomie, telle que proposée par le Maroc, s’appuie sur les principes de la Constitution de 2011 : démocratie locale, participation citoyenne et parité.
Les conseils régionaux de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab illustrent cette gouvernance inclusive, alliant identité sahraouie et responsabilité institutionnelle.
La dimension euro-africaine : l’Union européenne face à un choix stratégique
L’Union européenne, partenaire économique et politique majeur du Maroc, se trouve désormais à la croisée des chemins.
La neutralité prudente qui caractérisait jusqu’ici sa position devient difficilement tenable au regard des réalités internationales.
Cohérence politique et légitimité internationale
Ignorer la nouvelle architecture juridique onusienne reviendrait pour l’UE à fragiliser sa propre crédibilité.
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2023, suspendant temporairement les accords agricoles et halieutiques UE–Maroc, s’est trouvée dépassée par les évolutions diplomatiques récentes et par la reconnaissance accrue du rôle stabilisateur du Royaume dans la région[4].
Une révision politique s’impose donc : aligner la politique extérieure européenne sur la résolution 2025/692, au nom de la cohérence stratégique et du respect du multilatéralisme.
Un partenariat pour la stabilité et la sécurité
Le Maroc constitue aujourd’hui le principal pivot sécuritaire du flanc sud de l’Europe :
coopération antiterroriste, lutte contre la migration irrégulière, contrôle maritime et énergie propre.
Une clarification européenne renforcerait la sécurité collective euro-africaine, en consolidant le socle de confiance politique nécessaire à une coopération durable.
Une opportunité économique et énergétique
L’autonomie du Sahara créerait les conditions d’un essor économique partagé.
L’intégration de la région au Gazoduc Nigeria–Maroc, à la Route Atlantique Africaine et aux corridors de l’hydrogène vert positionne le Royaume comme interface énergétique et logistique entre les deux continents.
Les entreprises européennes pourraient y trouver un levier d’investissement vert, en phase avec le Pacte vert européen et la transition énergétique globale[5].
L’analyse de l’IIEG : vers une géopolitique du courage
Dans sa tribune “Pour une paix durable : 50e anniversaire de la Marche Verte”, le président de l’IIEG, Khaled Hamadé, écrivait :
“Le courage n’est pas de perpétuer les conflits, mais d’oser les résoudre. Le Maroc a montré la voie il y a cinquante ans. Il est temps que le monde l’accompagne sur ce chemin.”[6]
Cette déclaration résume la doctrine de l’IIEG : la paix n’est pas un statu quo, c’est un choix stratégique.
L’heure est venue pour les acteurs régionaux et internationaux — en premier lieu l’Union européenne — de passer du constat à l’engagement, du discours à la décision.
Une opportunité historique pour l’Europe et pour la paix
La résolution S/2025/692 marque le dépassement du paradigme postcolonial au profit d’une géopolitique de la responsabilité.
En s’alignant sur cette dynamique, l’Union européenne aurait l’occasion de renforcer sa présence dans une région stratégique, tout en consolidant un partenariat exemplaire avec le Maroc.
En définitive, il ne s’agit plus seulement d’un dossier africain, mais d’un enjeu euro-atlantique majeur :
celui de la stabilité du flanc sud, de la sécurité énergétique et de la cohésion entre les deux rives.
Le Maroc, par sa constance, sa légitimité et sa vision, offre à la communauté internationale une sortie honorable et durable d’un différend hérité du XXe siècle.
L’IIEG continuera de suivre cette évolution et de contribuer, par ses travaux, à l’élaboration d’une diplomatie du réalisme et de la paix, fidèle à l’esprit de la Marche Verte et à la vocation universelle du Maroc.
Notes et références
[1] Rapport de James Baker II au Conseil de sécurité, Nations Unies, 2004.
[2] Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental, document ONU S/2025/588.
[3] Banque africaine de développement (BAD), “Le Maroc et la nouvelle économie atlantique”, Rapport 2024.
[4] CJUE, Affaire T-344/19 et T-356/19, arrêt du 29 septembre 2023.
[5] Ministère marocain de la Transition énergétique, “Feuille de route nationale de l’hydrogène vert”, Rabat, 2024.
[6] Khaled Hamadé, “Pour une paix durable : 50e anniversaire de la Marche Verte”, Institut International d’Études Géopolitiques (IIEG), octobre 2025.
Pour une paix durable : 50e anniversaire de la Marche Verte et appel à la communauté internationale